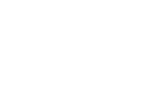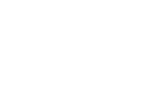|
Droit de propriété |


















|
RASSEMBLEMENT POUR LA LIBERTE |
|
Seul un peuple libre et indépendant peut connaître le bonheur et la joie de vivre ! |
|
La liberté constitue un idéal presque irréalisable : tous les gouvernements qui se sont succédés à ce jour, sans exception, de droite comme de gauche, ont porté atteinte à nos libertés depuis 1789 ! La liberté est le but et la raison d’être du Rassemblement Pour la Liberté (R.P.L. en abrégé) Liberté, égalité pour tous |